Dans votre livre, vous rappelez que le mot « gloire » signifie « ce qui a du poids » : qu’est-ce qui a du poids chez les bons à rien puisque, précisément, ils ne sont bons à rien ?
Père Sylvain Detoc : Vous avez raison, le titre du livre est à décoder ! Bien sûr, personne n’est « bon à rien » aux yeux de Dieu. Notre poids, nous dit la Bible, ressemble à celui d’un métal précieux. À nos propres yeux, certes, nous ne sommes pas très brillants… Nous nous sentons souvent lourds et opaques : lourds de notre pâte humaine et lourds de notre péché. Eh bien ! l’un n’empêche pas l’autre, si l’on suit saint Irénée de Lyon. Ce grand docteur expliquait aux chrétiens de la fin du IIe siècle que chacun de nous est un chef-d’œuvre façonné par Dieu : notre glaise, Dieu la pétrit ; elle est dans sa main ! Et Dieu ne s’arrête pas là : cette glaise, en Jésus, Dieu la revêt d’or pur, pour qu’elle devienne toute lumineuse. Bref, notre condition humaine, si minérale, n’est pas évacuée, mais transfigurée. Quelle alchimie !
« Notre valeur auprès de Dieu ne vient pas de nos mérites, comme si nous pouvions « acheter » l’estime de Dieu »
Si la gloire est « ce qui a du poids », ne faut-il pas chercher ce poids, ce qui pèse, autrement dit ne faut-il pas chercher à être valeureux ?
Je distinguerai deux sens de « valeureux ». Être valeureux, c’est avoir de la « valeur », n’est-ce pas ? Or notre valeur auprès de Dieu ne vient pas de nos mérites, comme si nous pouvions « acheter » l’estime de Dieu. Dans la deuxième prière eucharistique de la messe, par exemple, le prêtre dit « tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi » ; pourtant, quelques minutes plus tard, nous disons tous ensemble : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Alors, dignes ou pas dignes ? Par nous-mêmes, effectivement, nous ne sommes pas dignes de Dieu ; mais Dieu, Lui, pose sur nous un regard qui nous rend dignes. Notre valeur, donc, c’est d’abord de Lui qu’elle vient, pas de nous. Mais une fois que nous avons découvert notre valeur inestimable sous son regard, alors oui, nous avons envie de devenir « valeureux », c’est-à-dire, au second sens du terme, « braves », « courageux »… bref, meilleurs.
Comment donc trouver l’équilibre entre la quête de gloire propre à l’homme et l’exigence chrétienne de l’humilité ?
Depuis le péché originel, Satan nous fait croire que notre relation avec Dieu ressemble à un bras de fer. C’est son mensonge le plus réussi. Non. Il n’y a pas de rivalité entre le Créateur et ses créatures. « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » (saint Irénée, encore !). Déployer notre humanité – tout en ayant conscience de nos limites – ne fait pas d’ombre à Dieu, au contraire. Les enfants font-ils du tort à leurs parents quand ils s’épanouissent ? Non, évidemment. Cela ne les empêche pas de savoir que tout ce qu’ils ont, et même tout ce qu’ils sont, ils le doivent à leurs parents d’une manière ou d’une autre. Être humble, c’est être reconnaissant et lucide. L’humilité n’entraîne pas un misérabilisme pieux, mais un profond réalisme.
Avez-vous un exemple pour comprendre cela ?
Je pense à sainte Bernadette Soubirous, à qui la Vierge Marie est apparue à Lourdes – c’est à Lourdes qu’est né mon livre, pour les pèlerins du Rosaire, pèlerinage dominicain dont j’étais le prédicateur en octobre 2022. La famille de Bernadette était plongée dans la misère quand les apparitions ont commencé ; la gamine était quasi analphabète. Mais sa forte personnalité, Bernadette ne s’est pas privée de l’exercer : joyeuse et libre, devant les prêtres comme devant les autorités anticléricales de la ville. Bien plus tard, à Nevers, une jeune religieuse la voit arriver et s’exclame, dépitée : « C’est ça, Bernadette ? » ; notre sainte ne se démonte pas et répond : « Eh oui, ce n’est que ça ! » On se souvient aussi de sa réponse aux incrédules : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire. » Être une sainte ne signifie pas forcément exténuer son humanité…
« En chaque personne, nous verrions un saint en puissance si nous la regardions comme Dieu la regarde. »
Revenons à votre livre. Le bon à rien, n’est-ce pas celui qu’on punit avec un bonnet d’âne et qu’on met dans un coin ? Qu’y a-t-il de séduisant, à vos yeux, chez un tel homme ?
Effectivement, ce n’est pas glorieux. Les nuls ne sont pas attirants. Pire encore, ils se convainquent eux-mêmes qu’ils ne feront pas l’affaire, qu’ils sont incompétents… En relisant la Bible d’une façon un peu impertinente, comme je l’ai fait dans ce livre, on découvre que ces gens-là ne déplaisent pas à Dieu. Lui, il voit le « potentiel » de bonté que sa grâce peut faire fructifier en eux. En chaque personne, nous verrions un saint en puissance si nous la regardions comme Dieu la regarde. Le vieil Abraham, Moïse le bègue, Gédéon le nain, Amos le « bouseux », et tant d’autres encore : la plupart n’ont pas commencé leur « carrière » en attirant l’attention de Dieu en vertu de leurs compétences. C’est l’inverse, là encore. Dieu les a rendus capables d’accomplir leur mission, au fur et à mesure de leur chemin de communion avec Lui. Saint Paul compare les apôtres à des vases d’argile renfermant un trésor. Au moins, avec les bons à rien, on ne risque pas de confondre le Message et les messagers. Voilà qui devrait nous faire réfléchir en ces temps de désillusion ecclésiale.
Sans aller jusqu’à promouvoir le surhomme nietzschéen, ne faut-il pas aspirer à être des hommes forts, solides et fermes ?
« Un homme, ça ne pleure pas, mon garçon ! » Vraiment ? Ce n’est pas ce que disent les grands monuments de la littérature mondiale. Dans l’Iliade et l’Odyssée, les héros d’Homère pleurent très souvent. Dans La Chanson de Roland, aussi : Charlemagne et ses chevaliers ne craignent pas de montrer leurs sentiments. Les vies de saints, comme celle de saint Dominique, sont pleines de larmes également. Ce besoin qu’a l’homme moderne de retenir ses émotions pour ne pas perdre la face pose bien des questions. Pour un chrétien, cependant, c’est en Jésus qu’éclosent les vraies réponses : être l’homme le plus « accompli » que la terre ait porté n’évacue pas les larmes sur Lazare, les tressaillements d’allégresse en compagnie des petits, la colère contre les vendeurs du Temple, l’angoisse de l’Agonie, le cri d’abandon sur la croix… Aujourd’hui, les idéologies du « genre » exacerbent les passions autour du masculin et du féminin. La foi, elle, ramène le projecteur sur l’humain. Être chrétien ne nous dispense pas d’être humain.
« Découvrir par la foi que notre vie n’est pas destinée à faire naufrage dans la tombe mais à fleurir dans la lumière de Dieu, c’est la source d’une joie et d’une paix immenses. »
Nous autres, hommes du quotidien et de l’ordinaire, devons-nous nous contenter d’être juste ce que nous sommes ? Ne devons-nous pas viser plus : être chaque jour un peu meilleur que la veille ?
Aller plus haut, oui, mais à condition de partir sur une bonne base. Se contenter d’être des créatures, par définition limitées, voilà qui est indispensable. Le fantasme de « toute-puissance », c’est ruineux et épuisant ! Sous cet angle, si l’impression cuisante de notre faiblesse nous aide à consentir au réel, tant mieux. Mais le « potentiel » de bonté que j’évoquais tout à l’heure doit se déployer. Le christianisme n’est pas une sinécure. La parabole des talents le montre : fructifier est une exigence évangélique. Du reste, le mauvais serviteur de la parabole, Jésus le traite de « bon à rien », et son sort final n’est pas très enviable. Assurément, l’Évangile n’est pas un encouragement à la médiocrité. En somme, le curseur, je le bouge à tâtons pour arriver à la juste mesure : accepter d’être ce que je suis, accepter d’être qui je suis ; mais ne pas me résigner pour autant à vivre en-deçà du projet de Dieu sur moi.
Finalement, votre livre est-il une invitation à se réconcilier avec soi-même ?
Oui : si le lecteur est mis sur la voie de cette réconciliation avec sa condition humaine et son histoire personnelle, je n’aurai pas écrit ce livre pour rien. Mais mon intention n’est pas de donner dans le genre « développement personnel ». Cette démarche est trop « horizontale » ; elle risque de laisser la personne dans une posture très autocentrée. La foi, au contraire, est une réponse à l’invitation solaire que Dieu nous lance, elle nous tourne vers Lui comme des tournesols. La vie chrétienne consiste finalement à marcher sur une ligne de crête : avancer entre les chimères d’un idéalisme religieux qui frôle l’infrahumain au nom du surnaturel, d’un côté, la résignation à la médiocrité de notre vie terrestre, de l’autre. Sans doute faut-il du temps pour que cette marche s’accomplisse et peut-être des faux pas dans un sens ou dans l’autre.
Que souhaitez-vous aux hommes qui sont en train de lire cet entretien ?
Je leur souhaite de goûter le bonheur de se savoir dans la main de Dieu, même quand ils ont l’impression d’être loin de Lui. Sa main, Dieu ne la retire pas. Comprendre que notre vie est tirée du néant par Quelqu’un qui n’a pas d’autre motif que son immense bienveillance et découvrir par la foi que cette vie n’est pas destinée à faire naufrage dans la tombe mais à fleurir dans Sa lumière, c’est la source d’une joie et d’une paix immenses.
Propos recueillis par Joseph Vallançon

Résumé du livre par l’éditeur :
Des nuls. Des bons à rien. Des incompétents. Hélas ! Voilà ce que nous sommes à côté des vedettes de l’évangélisation et des champions de la vie chrétienne…
Vraiment ? Et si les grandes figures bibliques elles-mêmes étaient plus proches des « sous-doués » que des héros de péplum ? Et si Dieu était en fait un très mauvais DRH ? Abraham et Sara ? Trop vieux, Moïse ? Jérémie ? Trop bègues. On n’en finirait pas de relever les défauts que font valoir les amis de Dieu pour s’interdire d’être choisis. Et dans le Nouveau Testament, le recrutement n’est guère plus brillant. Pierre ? Un lâche. Paul ? Un fanatique. Sans parler de Marie-Madeleine ! Pourtant, ce sont ces frères et sœurs en humanité que Dieu a engagés au service de la mission la plus incroyable de tous les temps : annoncer l’Évangile. Cessons donc de vouloir à toute force nous défaire de notre pâte humaine ! Cette glaise a beau nous paraître lourde, Dieu l’appelle à partager sa gloire. Un livre plein d’humour pour nous réconcilier avec notre humanité.
La gloire des bons à rien, Sylvain Detoc, Le Cerf, 160 pages, sept. 2022, 16,00€





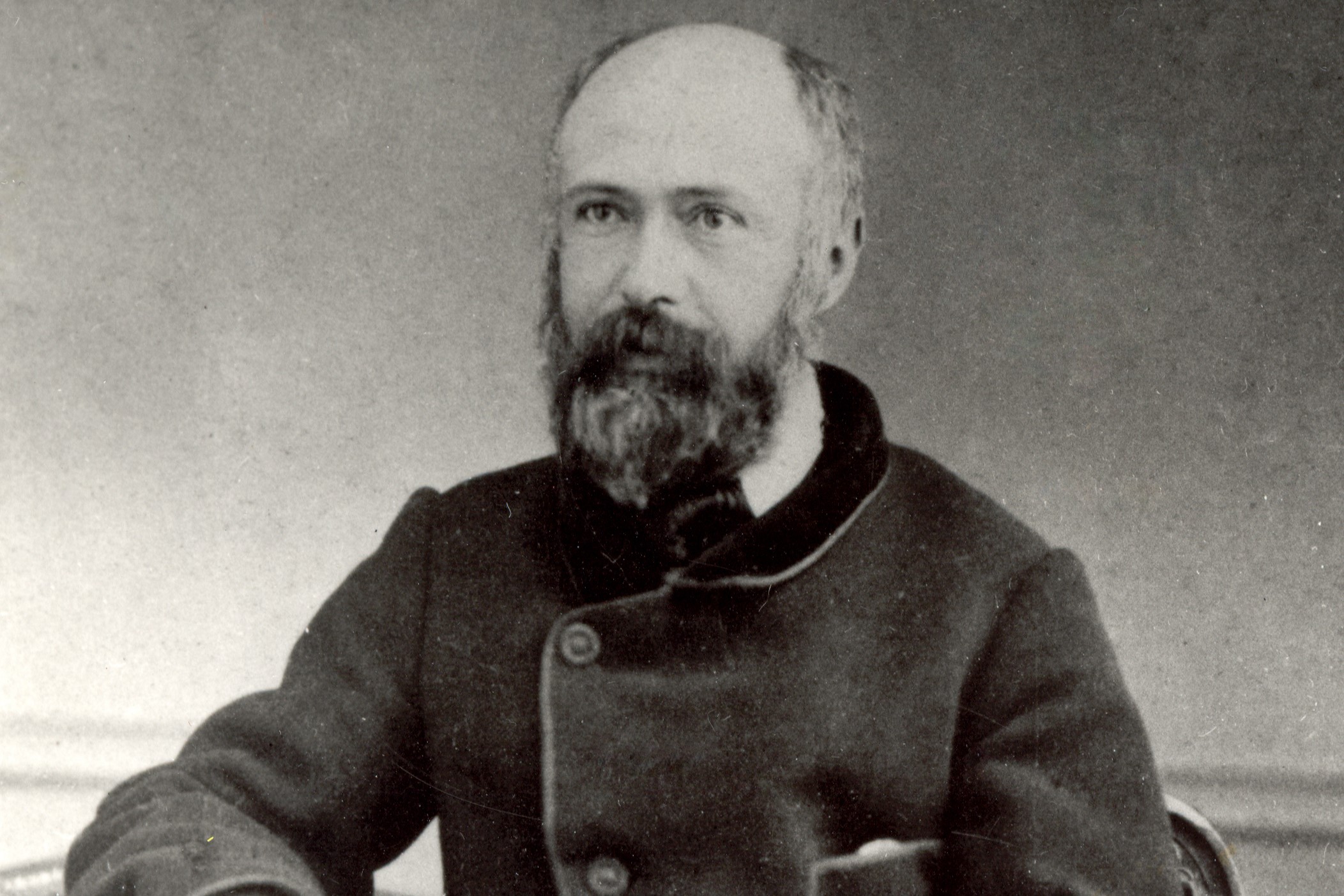








j’ai particulièrement apprécié ces lignes dans cet interview autour du thème « les bons à rien » :
Et aussi la réponse de l’auteur à cette question :
« Un homme, ça ne pleure pas, mon garçon ! » Vraiment ? Ce n’est pas ce que disent les grands monuments de la littérature mondiale. Dans l’Iliade et l’Odyssée, les héros d’Homère pleurent très souvent. Dans La Chanson de Roland, aussi : Charlemagne et ses chevaliers ne craignent pas de montrer leurs sentiments. Les vies de saints, comme celle de saint Dominique, sont pleines de larmes également. Ce besoin qu’a l’homme moderne de retenir ses émotions pour ne pas perdre la face pose bien des questions. Pour un chrétien, cependant, c’est en Jésus qu’éclosent les vraies réponses : être l’homme le plus « accompli » que la terre ait porté n’évacue pas les larmes sur Lazare, les tressaillements d’allégresse en compagnie des petits, la colère contre les vendeurs du Temple, l’angoisse de l’Agonie, le cri d’abandon sur la croix…
Merci à l’interviewer et à l’interviewé !