Le témoignage d’un moine de l’abbaye de Sept-Fons, publié récemment par La Croix, jette une lumière vive sur ce qui semble être une forme d’emprise au cœur d’un monastère. Un nouveau cas qui résonne avec d’autres figures marquantes : Fr. M.-D. Philippe (Communauté Saint-Jean), Jean Vanier (l’Arche), le cardinal McCarrick aux États-Unis, Marcial Maciel (Légionnaires du Christ), l’abbé Pierre (Emmaüs), autant de noms désormais synonymes d’abus de pouvoir spirituel, souvent maquillés en ferveur religieuse.
À la suite du rapport Sauvé (Ciase), une ligne de fracture s’intensifie dans l’Église : entre les exigences évangéliques et certaines pratiques d’accompagnement dont les mécanismes sont désormais connus et dénoncés. Les psychologues et psychanalystes se soumettent à des supervisions régulières pour interroger leurs pratiques. Pourquoi les accompagnateurs spirituels ne bénéficieraient-ils pas eux aussi d’un cadre éthique exigeant, articulé à une lecture renouvelée des Évangiles en lien avec les sciences humaines ? L’enjeu est double : restaurer la confiance et éviter de transformer la foi en outil de pouvoir.
Une tension au cœur de la foi
Sur le terrain pastoral, un constat s’impose : nous pouvons être tenté de considérer la foi comme un corpus de connaissances à assimiler, la fides quae, c’est-à-dire le contenu objectif de la foi. Un contenu transmissible, parfois même évalué, au détriment de la démarche personnelle et libre, la fides qua, pourtant première dans l’expérience spirituelle.
Cette inversion silencieuse traduit un abus de pouvoir potentiel : celle d’une logique institutionnelle qui privilégie la conformité du discours plutôt que la vérité du chemin intérieur. Sans verser dans la caricature, il faut pouvoir poser la question : cette tendance ne favorise-t-elle pas l’émergence d’un pouvoir symbolique subtil mais réel, qui valorise la maîtrise du langage religieux au détriment de l’expérience vécue ? Une telle normalisation ne menace-t-elle pas, in fine, la liberté spirituelle ?
Le style Jésus : une posture thérapeutique avant l’heure
Face à ce risque, les Évangiles offrent une proposition singulière. Jésus n’impose rien. Il écoute, interroge, invite à penser par soi-même.
- En Matthieu 5, 13, Jésus est « plein d’admiration » face à la foi du centurion que celui-ci exprime en dehors de tout cadre religieux institutionnel.
- Au chapitre 17, à propos de la légitimité de l’impôt, Jésus demande : « Quel est ton avis, Simon ? » (Mt 17, 25)
- Au jeune homme riche qui vient vers lui, il affirme en laissant entendre à son interlocuteur que la réponse est en lui : « Pourquoi m’interroges-tu sur le bon ? » (Mt 19, 16)
- À Bartimée, pourtant aveugle, il demande : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Mc 10, 51). Si le besoin semble évident, il ne présuppose pas.
- De même quand un légiste vient le trouver et lui demande comment avoir la vie éternelle, Jésus le renvoie à sa propre responsabilité : « Dans la loi, qu’est-il écrit ? Comment lis-tu ? » (Lc 10, 26)
- Aux disciples d’Emmaüs, il dit : « De quoi parliez-vous en marchant ? »(Lc 24, 17). Il entre dans le récit des disciples, les laisse parler longuement et entame un processus par lequel une vérité émerge à partir de leurs ressources propres.
- À la Samaritaine, il révèle sans forcer, dans un échange libre et progressif (Jn 4, 7-26)
- Au paralytique : « Veux-tu guérir ? » (Jn 5, 6)
- À propos de la femme adultère, en guise de réponse à la question qui lui est posée, il dessine sur le sol, protège sans condamner ni renier l’exigence éthique : « Va, et ne pèche plus. » (Jn 8, 11)
Partout, Jésus respecte le rythme, la liberté et l’histoire de l’autre. Il ne cherche pas à contrôler la foi, mais à la faire naître de l’intérieur.
Une conversion pastorale à opérer
Cette conversion suppose peut-être, de la part de l’accompagnateur, un renoncement à s’auto-référencer comme sujet sachant. L’accompagnement spirituel peut ainsi devenir le lieu du non-savoir. Ce retrait, qui sous-tend le dialogue1 herméneutique (qui concerne l’interprétation), instaure un climat discret, semblable au « murmure d’une brise légère » (1 R 19, 11-12) où la personne accompagnée peut se révéler à elle-même, en laissant se manifester ses potentialités enfouies.
L’attitude de Jésus est en ce sens résolument moderne. Elle est respectueuse du rythme et de la liberté de chacun. Elle n’exige aucune évaluation des connaissances ni contrôle de conformité morale ou doctrinal. Elle rappelle avec force qu’il n’y a pas d’accompagnement spirituel sans conversion de l’accompagnateur.2
Carl Rogers nous apprend que toute personne porte en elle une source intérieure de transformation, pour peu qu’on l’écoute sans jugement.3 François Roustang invite, quant à lui, à un effacement discret de l’accompagnant, afin que le mystère du sujet puisse advenir sans contrainte.4
À la manière des grands spirituels et des psychanalystes, tous deux rappellent que l’on ne guide pas une âme mais que l’on se tient à ses côtés, dans une présence humble, ouverte au surgissement des multiples possibles. Et si l’Église osait faire de cette posture une exigence de formation continue ? Une sorte de « supervision spirituelle », qui viendrait renforcer cette affirmation de Paul VI d’une Église « experte en humanité ».
Enfin, la question de la santé mentale des protagonistes impliqués dans les affaires d’abus ne doit pas être éludée. Elle ne concerne pas uniquement les cas pathologiques ou les comportements déviants. Elle engage toute personne investie dans une relation d’accompagnement. Le discernement devient double : il porte tant sur l’accompagné que sur l’accompagnateur.
La grâce, rappelait saint Thomas d’Aquin, « ne détruit pas la nature, mais la parfait ».5 Encore faut-il se souvenir que la nature humaine, blessée et libre, est une nature que nous portons tous en commun.
Yvan IORIO
- dia-logos : à travers une raison commune ↩︎
- « Écoutez, comprenez et témoignez. Prêtez l’oreille à la voix du Seigneur. Comprenez la vérité et témoignez d’elle. Vivez-la. Gardez le silence pour entendre et pour comprendre la voix du Seigneur. Mais gardez-vous de prêter l’oreille à l’écho de vos propres pensées et de n’écouter que vous-mêmes. Affranchissez-vous de vos idées et laissez la parole de Dieu les purifier, en retranchant ce qui est à éliminer, et en réécrivant ce qu’il faut réécrire » (Saint Charbel) ↩︎
- ROGERS, C. Le développement de la personne, 1970 ↩︎
- ROUSTANG, F. Il suffit d’un geste, 2003. ↩︎
- D’AQUIN, T. Somme Théologique, I, q. 1, art. 8, ad 2. ↩︎






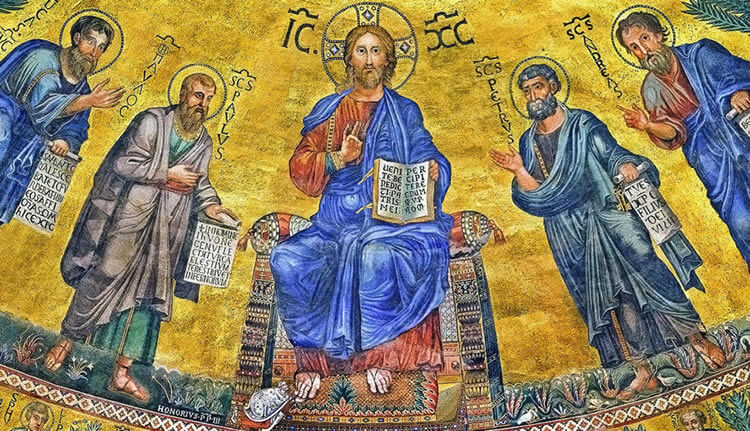
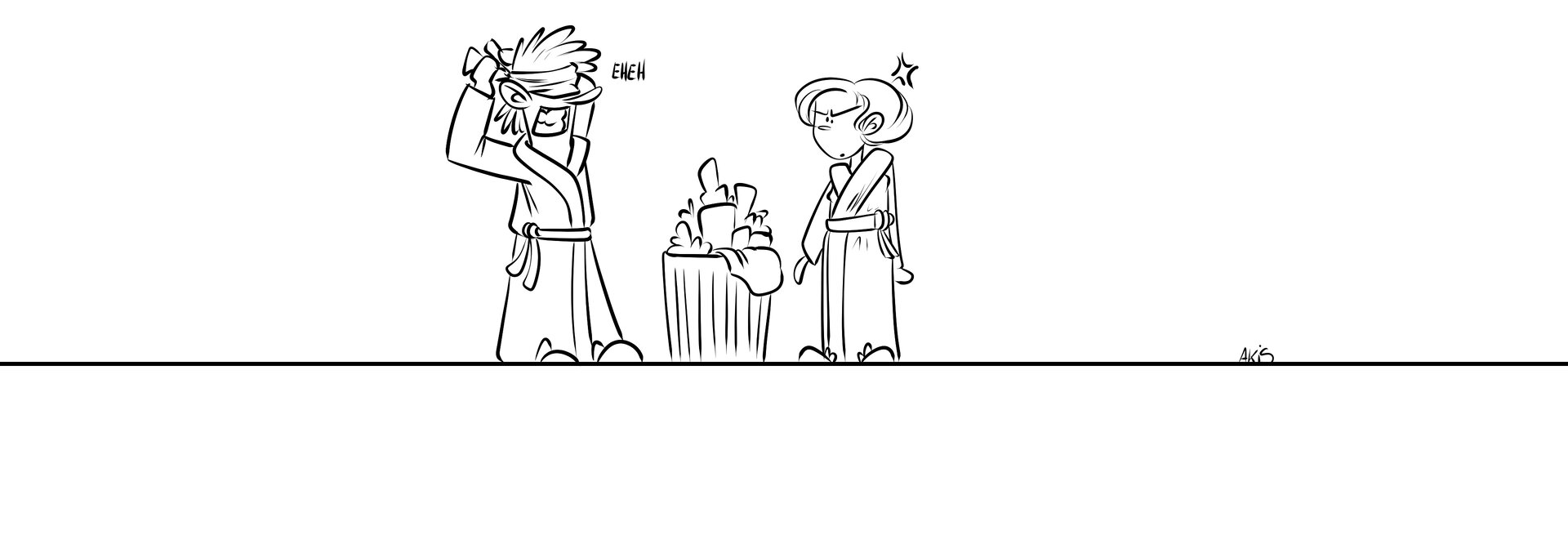



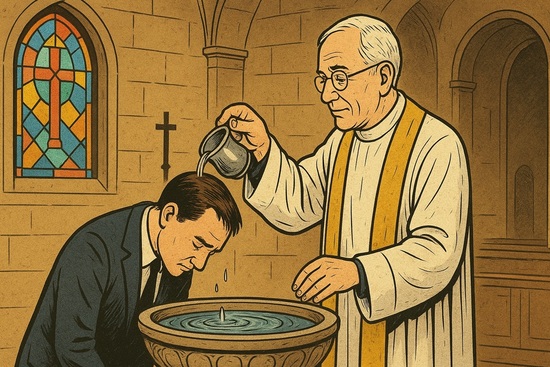



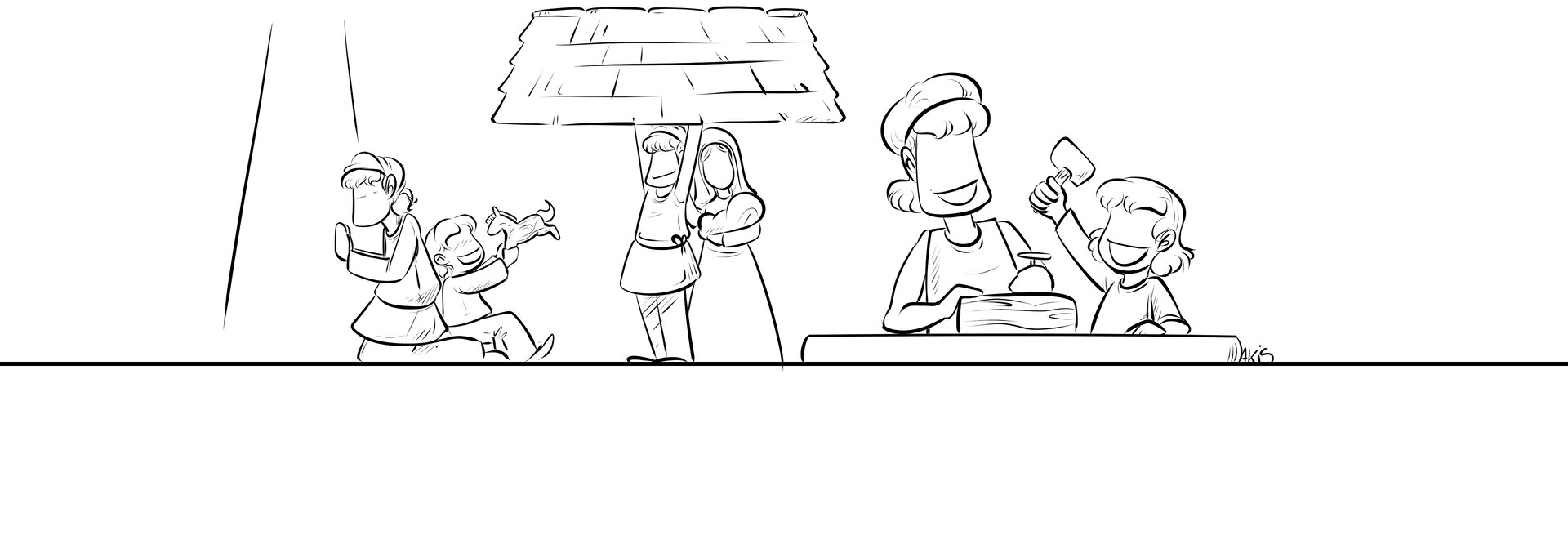

La réflexion d’Yvan IORIO sur les risques de l’accompagnement me parait de bon sens profond. J’ai apprécié les repères évangéliques qu’il rappelle : l’attitude de Jésus en différentes circonstances peut utilement guider accompagnateur et accompagné. Il est difficile pour un accompagnateur de ne pas abuser de son influence, cela demande beaucoup de vigilance. Je peux témoigner en avoir manqué. Il me semble que l’on devrait, dans tout accompagnement postuler les risques de dérive. on ne le fait pas assez quand il s’agit de religieux, de clercs, de personnes disposant d’une autorité morale.