Vous avez publié récemment un ouvrage sur les nouveaux baptisés et les « recommençants » convertis grâce à la liturgie tridentine : pourquoi ?
Philippe Pelissier : Parce que les signaux envoyés par Rome ces dernières années étaient plutôt anxiogènes comme l’a montré le motu proprio Traditionis Custodes du pape François. J’ai donc voulu contribuer à défendre la messe traditionnelle en cherchant à dissiper certains préjugés à l’égard d’une liturgie considérée comme liée à un petit milieu social et culturel fermé. Le missel de saint Pie V n’est pas la forme ecclésiastique de la chasse à courre !
Mais c’est tout de même un petit milieu en vase clos, non ?
Philippe Pelissier : Au contraire ! Cette liturgie est vivante et même attractive : pensez qu’elle représente plus de 10% des baptêmes d’adultes à Paris ! Nombreux sont ceux, en particulier des jeunes garçons et filles, français ou étrangers, de tous milieux, qui se tournent vers elle avec confiance. Chercher à les connaître et à les comprendre est nécessaire. C’est ce que j’ai voulu faire en recueillant leurs témoignages…
En quoi, selon vous, la forme extraordinaire ou traditionnelle de la liturgie catholique attire une part non négligeable des néophytes et des périphéries de l’Eglise ?
Philippe Pelissier : En écoutant les néophytes, mais aussi les recommençants, je note deux phénomènes majeurs. D’abord, beaucoup sont touchés par l’émotion qui se dégage de ces célébrations. En quelque sorte, on pourrait dire qu’ils « ressentent » la présence de Dieu sur l’autel. Ensuite, certains témoignent d’une approche plus intellectuelle en prenant en compte l’étroite adéquation des gestes et des attitudes du peuple et du prêtre, avec la théologie de l’Eucharistie (et notamment sa dimension sacrificielle). Mais si dans les deux cas, ces nouveaux fidèles admirent la dignité d’un office clairement tourné vers les réalités d’en haut, aucun des témoignages que j’ai recueillis ne mentionne d’abord les aspects esthétiques. Ils ne sont pas venus à la messe comme ils seraient allés au concert !
Quels seraient les points qui permettraient, selon vous, une meilleure coopération entre les différentes sensibilités de l’Eglise de France ?
Philippe Pelissier : Permettez-moi de citer Tertullien parlant des chrétiens qui vivaient à fond l’Evangile : « Voyez comme ils s’aiment ». Ne devrions-nous pas témoigner d’un esprit de respect mutuel, en laissant de côté les polémiques des années soixante-dix, en cherchant à nous connaître, en valorisant ce qui nous unit : je pense par exemple au catéchisme de 1992, aux dévotions populaires (chères au pape François) ou aux œuvres caritatives… Ne devons-nous pas répéter la formule de Benoît XVI : « Nul n’est de trop dans l’Eglise ». Ou reprendre celle de François (« todos, todos, todos »)?
Facile à dire… Sachant qu’il y a des œillères et des rigidités de certains catholiques progressistes, n’y a-t-il pas, aussi, du côté traditionnaliste, une forme d’esprit obtu, formaliste, voire rigide qui empêche cette coopération et ces solidarités avec le reste des différentes composantes de l’Eglise ?
Philippe Pelissier : Effectivement, je comprends que certains puissent avoir gardé le souvenir de quelques échanges rugueux dans le passé. Mais ne faut-il pas admettre que les « Tradis » se soient souvent sentis mal aimés et aient acquis des réflexes d’écorchés vifs ? Faut-il maintenir cette « rugosité » sachant que bien des fidèles de la liturgie traditionnelle sont issus de familles les ayant éduqués dans la liturgie nouvelle ? Pour ma part je crois aux vertus du dialogue, fondé sur le respect mutuel, qui peut décrisper et permettre d’avancer ensemble.
Quelle place, selon vous, l’homme chrétien devrait assumer dans notre société sécularisée, désenchantée ? Et comment transmettre ?
Philippe Pelissier : Je note que, parmi les hommes, ceux qui sont attirés par la liturgie traditionnelle apprécient sa rigueur (qui n’est pas la rigidité) et son ordre (qui n’est pas incompatible avec la charité). Dans une société déboussolée, l’homme chrétien devrait donc porter le souci de l’équilibre, de la maîtrise de soi et du respect de l’autre. Il doit symétriquement refuser l’émotion facile mais aussi la dureté et la cruauté gratuite. Poignarder à mort un inconnu est, par excellence, l’acte qu’un homme chrétien ne peut accomplir. C’est l’amour du prochain ̶ qui est cœur de la morale chrétienne ! ̶̶ que nous devons transmettre, pas seulement en parole, mais aussi ̶ et surtout ̶ par nos actes.
Propos recueillis par Guillaume Lecoq
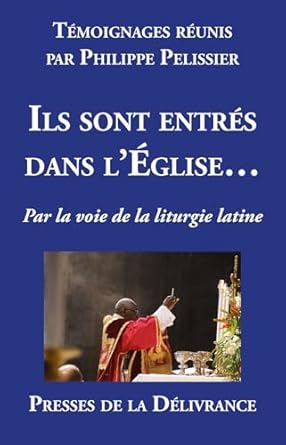
Philippe Pelissier a recueilli les témoignages – écrits ou oraux – de 41 néophytes, « frères séparés » rejoignant l’Eglise catholique ou encore « recommençants ». Ces nouveaux fidèles, majoritairement jeunes (ils sont nés aux environs de l’an 2000) viennent de milieux sociaux, ethniques ou religieux très divers, comme l’Islam. Mais ils ont en commun d’avoir été séduits par l’« esthétique » et la continuité historique de cette forme traditionnelle du rite. Au fil des pages, on découvre aussi le rôle des réseaux sociaux dans leurs démarches de conversion. Parmi eux, beaucoup sont des blessés de la vie : parents divorcés, addiction à la drogue et à la pornographie, etc. Un ouvrage qui manifeste le rayonnement encore lumineux de la messe tridentine.
Ils sont entrés dans l’Église… par la voie de la liturgie latine. Témoignages réunis par Philippe Pelissier, éditions Presse de la Délivrance, 2025, 282 pages, 20 euros.





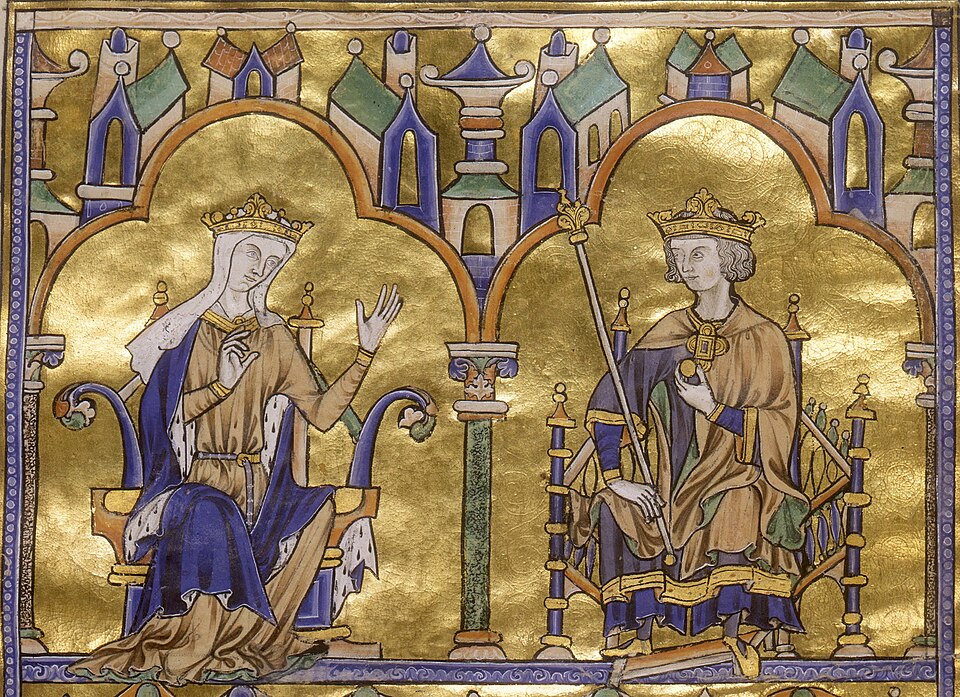






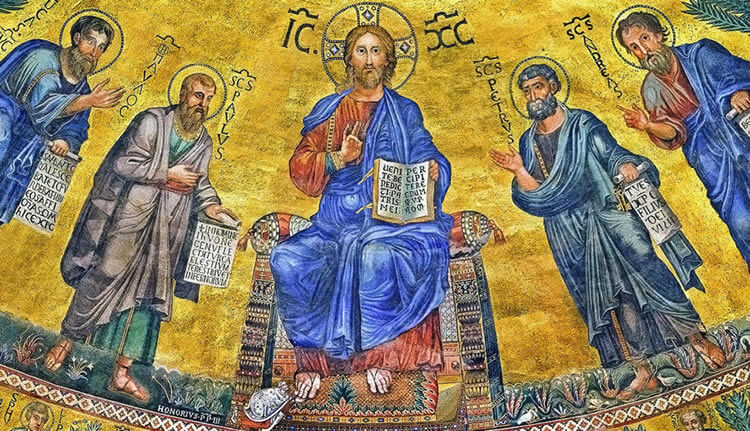
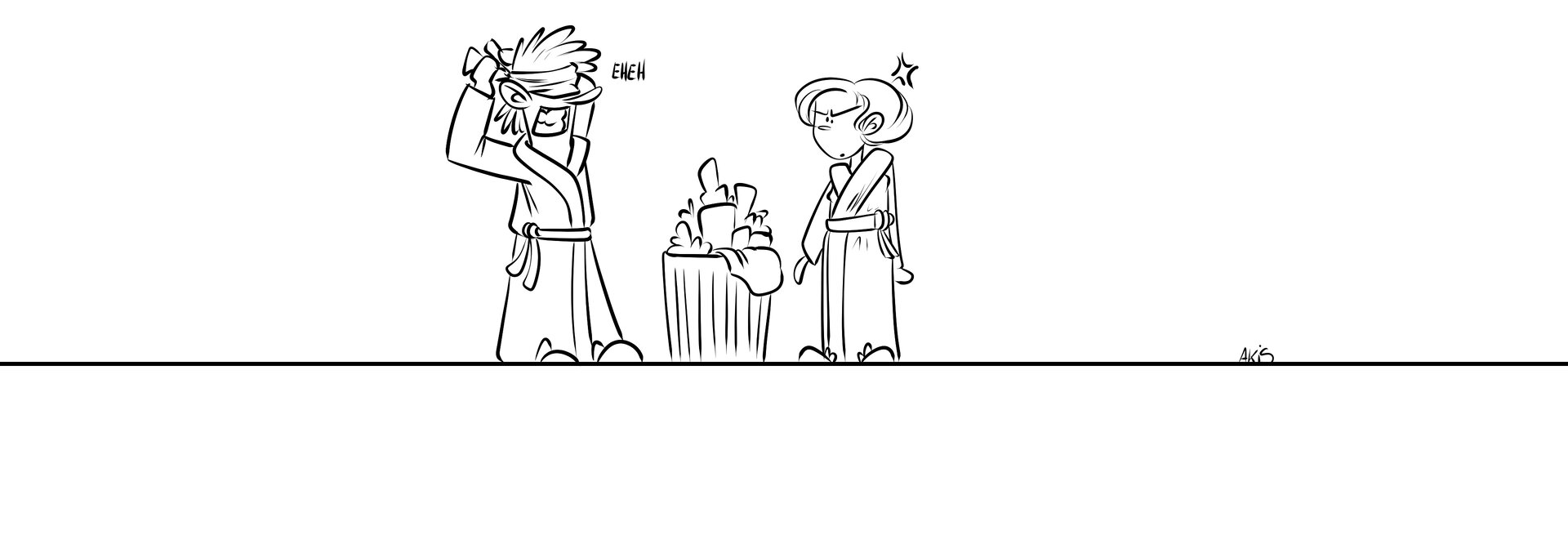



0 commentaires