Où l’on devient un peu moins maître de soi
Notre époque, confiante en ses formules, nomme vacances ce qui devrait s’appeler apprentissage. Car c’est bien à une école de la vie commune que nous invite l’été, avec l’étirement de sa durée, le retrait des rôles sociaux, l’impitoyable promiscuité.
On croyait partir pour se reposer : on se retrouve exposé. Livré à d’autres coutumes, d’autres rythmes, d’autres voix. Plus d’anonymat, ni d’issue. Reste l’espace partagé, les enfants qui surgissent dans le salon comme de petits souverains convaincus que tout leur est dû. Ils aident, puis s’affrontent. Ils rient, puis boudent. Et nous voilà emportés dans le tourbillon…
Dans ces jours denses, on redécouvre ce qu’Aristote nommait hexis : cette disposition que le corps et l’âme acquièrent à force d’habitude, de reprise. L’été agit comme révélateur. Il nous met à nu.
Ce pain qui nous travaille
Le Notre Père le demande : « Donne-nous aujourd’hui notre pain… » – epiousion.
Un mot rare, presque intraduisible. On dit parfois suressentiel. La tradition orthodoxe le rend par substantiel : plus qu’un aliment, ce sans quoi l’homme ne se supporte plus lui-même.
Ce pain, on ne le trouve ni dans les excursions, ni dans les pages d’un roman. Il se cache dans les gestes infimes : écouter la respiration d’un enfant endormi ; préparer un café pour son beau-frère ; accueillir, sans réplique, un propos véhément qui heurte.
Ces gestes n’ont rien d’héroïque. Et pourtant, ils sont tout. À Port-Royal, les religieuses vivaient entassées dans des cellules étroites. Pascal y comprenait que l’homme ne s’élève qu’en acceptant la gêne, lorsqu’il renonce à fuir la charité. « Car tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre.[1]»
L’amour, le vrai, commence dans cette gêne-là. Il ne consiste ni en exaltation ni en fusion. Il prend racine dans le consentement à la présence de l’autre, même dans sa dissonance.
Il ne s’agit point de se courber. Il s’agit de s’ajuster, sans céder l’essentiel.
Descendre dans l’âme
Il est un enseignement rude, venu du mont Athos : « Tiens ton esprit en enfer, et ne désespère pas.[2] » Saint Silouane, qui le reçut dans la prière, ne cherchait point l’ascèse pour elle-même, mais pour retrouver Celui qui, même caché, ne se retire jamais tout à fait.
La vie commune estivale offre une version mineure de cette descente. On se sent trop, de travers, inadapté ; on préférerait s’effacer, et on rêve d’un peu de retrait. Or, il faut rester. Par fidélité et finalement, par amour.
Le Christ l’avait dit : « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? » (Matthieu 5:46) Aimer, lorsque tout conspire à la lassitude, à l’impatience, à l’aigreur… n’est-ce pas là le commandement dans sa vérité nue ?
Et lorsque, entre la vaisselle et la veillée, se trouve un instant de retrait, alors, on prie. Mal. Un peu. Mais on prie. La prière ne vient pas sauver la journée. Elle l’enracine. Véritablement, elle la rend possible.
Faux vide, que ces vacances ! Vrai plein ! Et dans cette plénitude, nous apprenons à goûter le prix de ce pain que l’on n’a pas choisi, mais que nous recevons : le suressentiel.
Clément Bosqué
[1] Blaise Pascal, Pensées, fragment Lafuma 136, Brunschvicg 139.
[2] Archimandrite Sophrony, Saint Silouane l’Athonite, éditions Présence orthodoxe (Paris).





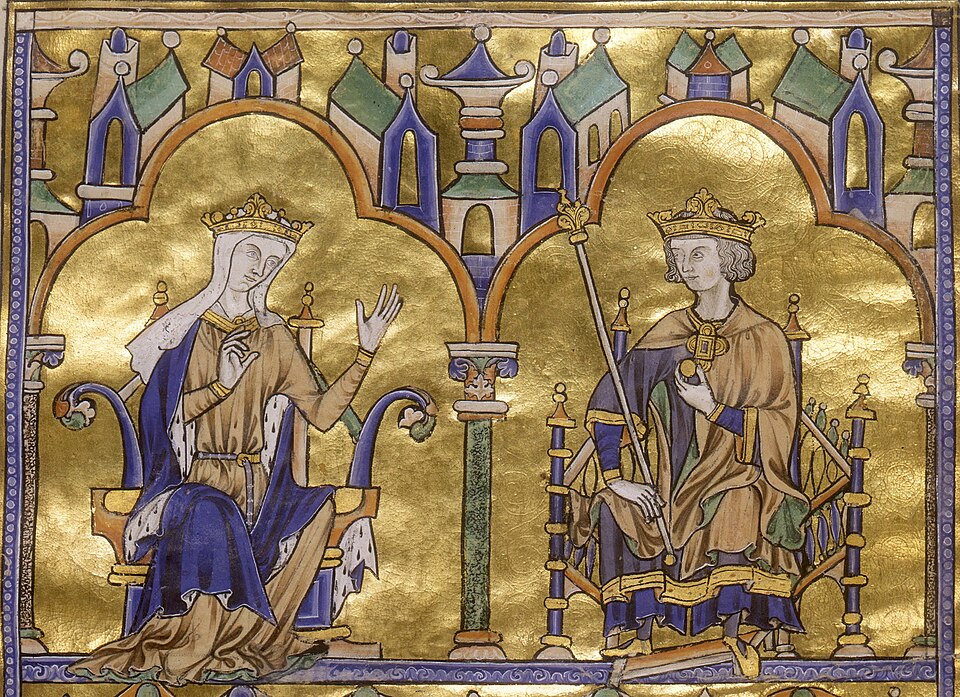






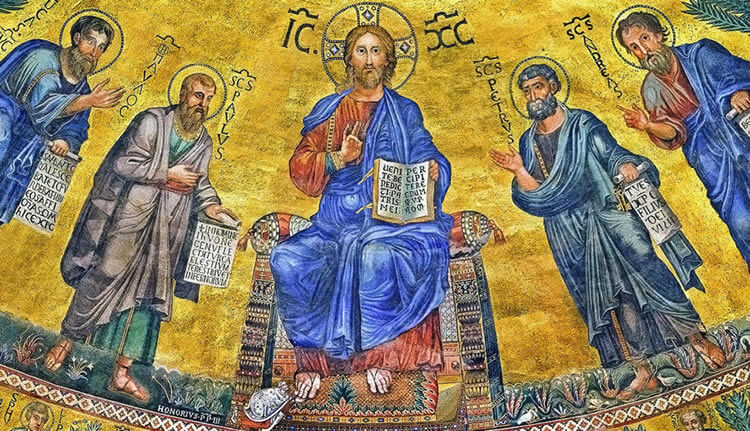
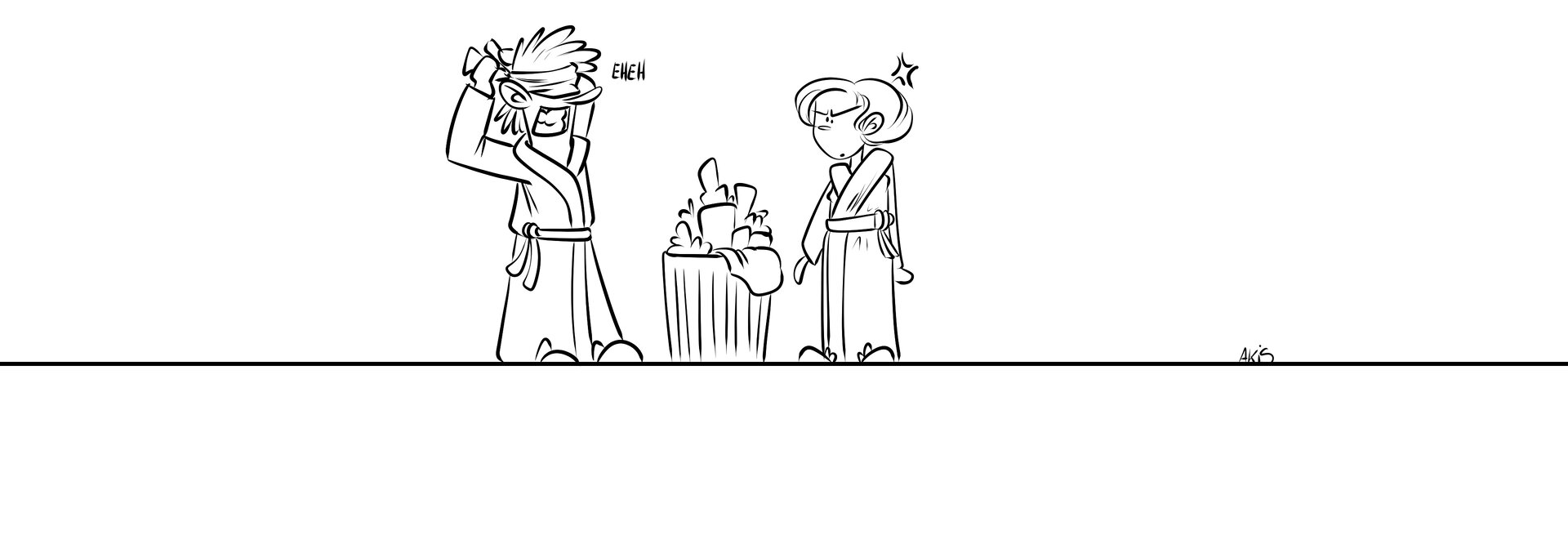



0 commentaires