A la fin de l’Antiquité, la Provence est paradoxale : gouvernée par l’argent et le commerce, elle est ouverte autant aux invasions qu’au christianisme. Certaines figures vont y fonder un monachisme enraciné et fécond.
La graine monastique semée en Provence
Le personnage emblématique de la chrétienté provençale est bien sûr saint Honorat, un gallo-romain d’abord parti vers l’Orient pour évangéliser des contrées lointaines, mais finalement de retour en Provence lorsque l’évêque local lui fait don d’une île déserte dans l’archipel de Lérins. Honorat, qui était d’abord attaché à la solitude, se retrouve à la tête d’un grand groupe cénobitique (avec une vie communautaire, par opposition aux ermites). Il sera finalement appelé en 425 à la tête du diocèse d’Arles. Evêque unificateur et vivifiant, il prend appui sur l’œuvre d’un autre moine : Jean Cassien.
Ce dernier, venu de Roumanie, fut moine à Bethléem, puis Père du désert en Egypte. Jean Chrysostome le fait diacre et l’envoie à Rome, où il est ordonné prêtre. C’est alors qu’il arrive à Masilia (Marseille), et fonde deux monastères vers 414 : Saint-Victor (pour les hommes) et Saint-Sauveur (pour les femmes). Sa Règle de vie n’est pas son seul apport littéraire : il luttera dans d’autres textes contre les hérésies, notamment celle de Nestorius qui prétendait qu’en Jésus existaient deux personnes, l’une divine et l’autre humaine. Saint Jean Cassien poursuivra le culte de Sainte-Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, où il fonde un ermitage et un couvent. Sans rechercher le savoir et la gloire, il conseillait au contraire à ses moines : « Empresse-toi d’acquérir une humilité de cœur inébranlable [qui] te conduira ».
Ainsi, la vie monacale germée au début du Ve siècle fut la porte d’entrée par laquelle l’Evangile entra en Provence, malgré le tumulte de la ville et le fracas de la mer.
Du monastère à la Cité
Ces monastères n’ont pas gardé pour eux les bienfaits dont les comblait le Christ : ces lieux sont devenus des foyers de formation, d’évangélisation, d’écriture et de rayonnement culturel et spirituel. Ils ont également servi de « pépinière » pour revivifier le clergé local : saint Honorat ne fut en effet pas le seul moine de Lérins à devenir évêque puisqu’il fut suivi d’autres grandes figures comme Hilaire d’Arles ou Eucher de Lyon. La vie intérieure elle-même put être transmise aux citadins les plus érudits grâce aux œuvres écrites de certains abbés, comme les Institutions et Conférences de saint Jean Cassien. S’en suivront mille ans de rayonnement bénédictin : ces abbayes furent foyers de copie, d’accueil, de justice locale et de formation du clergé. Sans bruit, elles forgèrent la civilisation.
A partir du XIIe siècle, la civilisation devient davantage urbaine et ce sont alors les ordres mendiants qui apportent le message chrétien aux portes de chaque village. Ces communautés, notamment leurs branches féminines, ont joué un grand rôle dans l’enracinement d’une véritable piété urbaine, à l’image des Dominicaines d’Aix-en-Provence. Ces ordres, parfois en concurrence, étaient néanmoins le rayonnement vivant de la chrétienté, qui visait à bâtir une charité civile par la formation et la transmission, ce qui permettait de susciter de nombreuses vocations.
Cependant cet apport en novices s’atténua et la vie monastique finit par diminuer. On observe, par exemple, ce déclin avec le monastère de Ganagobie, fondé dès le Xe siècle et d’abord bien pourvu en richesses et en vocations, puis peu à peu délaissé (il n’y restait que trois moines en 1789, et un seul en 1900). Récemment, une nouvelle communauté s’y est heureusement installée (les moines de Sainte-Marie-Madeleine de Marseille) et la liturgie des heures résonne à nouveau entre les fresques et les sarcophages romans.
L’héritage provençal : une résilience virile et chrétienne
Les moines de Provence n’étaient pas des contemplatifs retirés du monde : ils ont constitué des bastions de la foi, des forteresses spirituelles au cœur d’un paysage agité. Les murs de l’île Saint‑Honorat-Abbaye de Lérins, dressés face à la mer, en sont le symbole. Ce lieu fut exposé aux raids sarrasins, aux pirates, aux assauts venant de la mer. Les moines ne ployaient pas : ils fortifiaient, ils veillaient, ils se tenaient debout. Ce double visage (à genoux pour prier, debout pour combattre) donne tout son poids à l’héritage provençal : une présence virile et sacrée plutôt qu’une retraite cachée. L’abbaye a subi plusieurs attaques où les moines furent dispersés ou martyrs (comme lors du massacre de Lérins en 732 où environ cinq cents membres de la communauté furent tués par les Omeyyades). Mais le combat concernait surtout la nature de l’homme pécheur, comme l’illustrent ces mots de saint Honorat : « Il faut que l’esprit reconnaisse sa nature supérieure et livre combat aux vices charnels. »
Et la lumière n’a pas vacillé : une vie monastique renaîtra et l’antique liturgie reprendra grâce au combat mené par les anciens, quand le silence de prière se mêlait à la veille sur la muraille. C’est leur héritage spirituel : le monachisme provençal, même s’il a décliné, a laissé un réseau d’abbayes, de saints, une tradition de gravité intérieure, de liturgie assidue et d’ascèse au service de la cité. Il n’était pas question de fuir le monde mais de le purifier par la vie intérieure et de l’éclairer par l’Évangile.
Un appel pour aujourd’hui
Aujourd’hui encore, l’homme chrétien est appelé à cet équilibre : solitude pour écouter Dieu, liturgie pour structurer son âme, ascèse pour forger sa constance — mais tout cela non pas pour se retirer, mais pour être un levain, une présence de foi, de vertu et de don dans le travail, la famille, la cité. La solitude, la liturgie, l’ascèse ne sont pas une retraite du réel : elles en sont l’armature. L’homme chrétien ne se contente pas d’aimer dans l’ombre : il bâtit, il veille, il protège la vérité, il soutient l’édifice de la civilisation chrétienne. Dans son foyer, son entreprise, sa paroisse, il est à la fois ermite et sentinelle. Il est héritier, mais aussi artisan.
Être chrétien aujourd’hui, ce n’est pas se retirer du monde : c’est veiller sur lui.
Christophe de Guibert
Bibliographie :
. Les Pères de l’Eglise (Hubertus R. DROBNER , Desclée, 1999)
. Moines et religieux dans la ville XIIe-XVe siècle (Cahier 44 de Fangeaux, éditions Privat, 2009)
. La dévotion monastique féminine en Provence fin Xe-XIe siècles (Eliana Magnani, HAL, 1994)




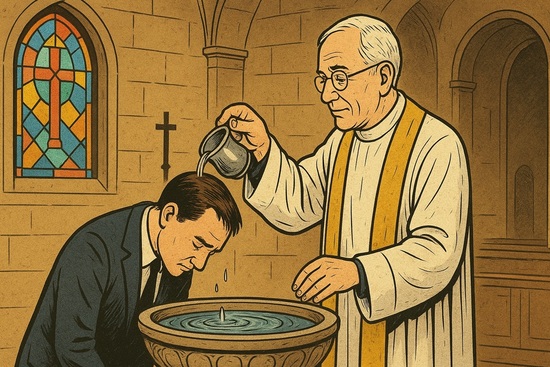



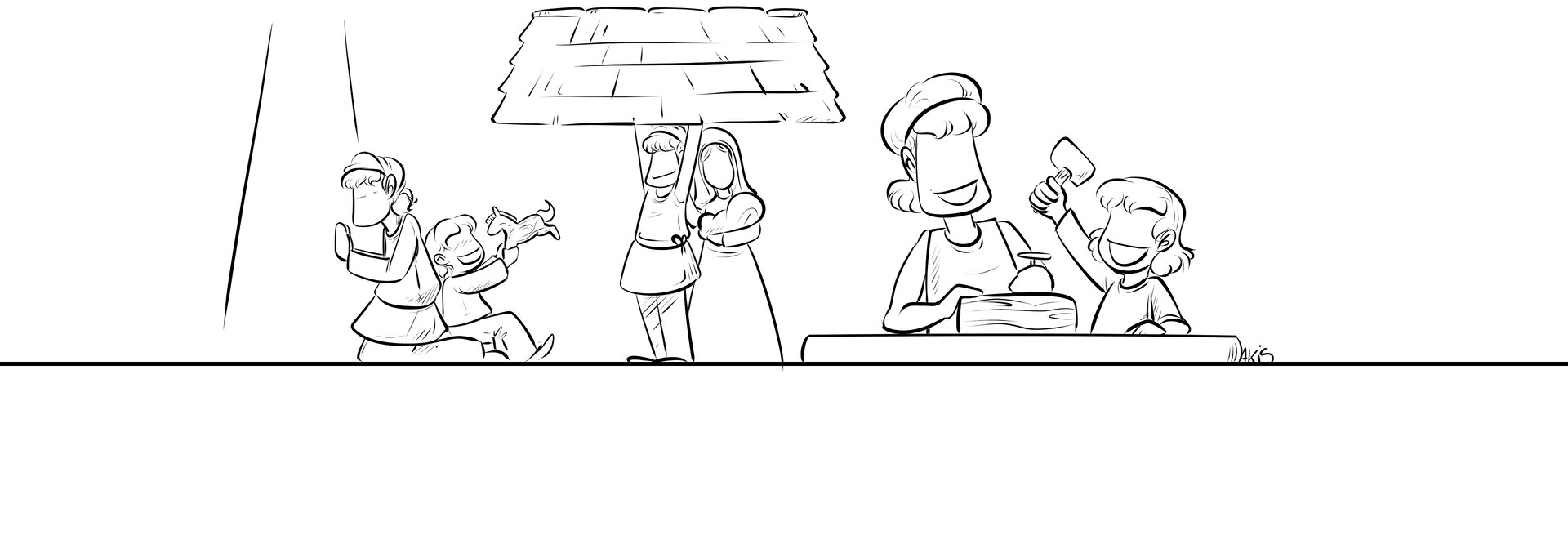




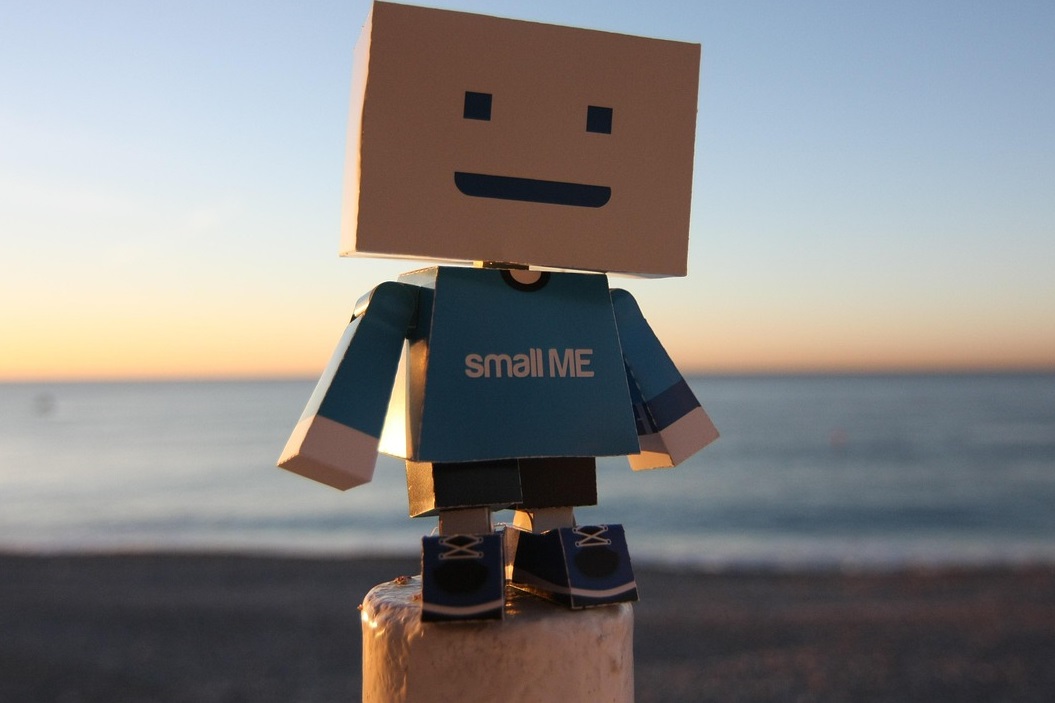
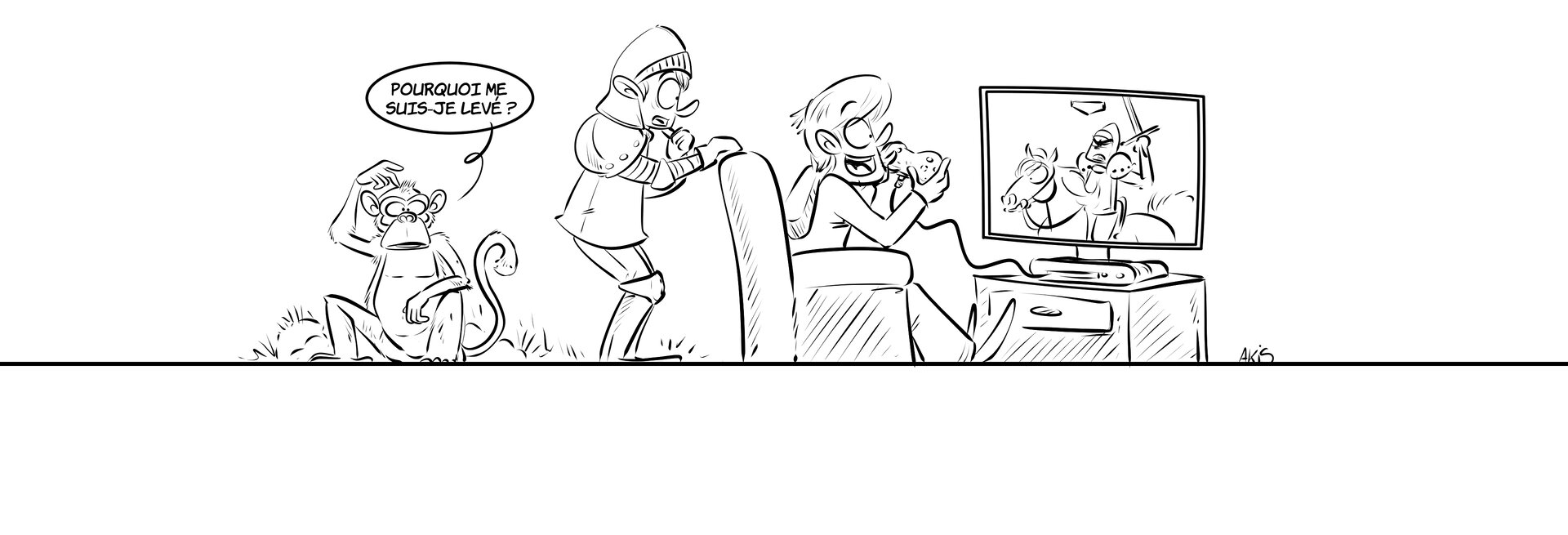


0 commentaires